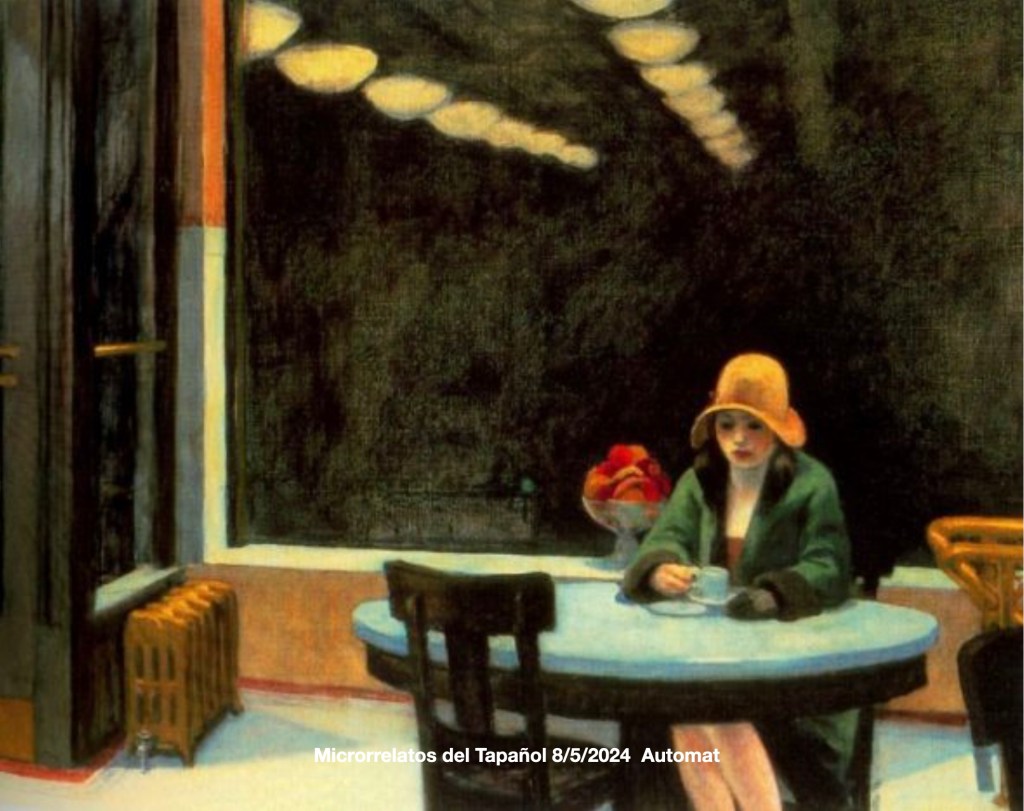Madeleine era esausta, tutto il suo corpo tremava sotto il peso meraviglioso di Georges, il suo amante da sempre, un bel pezzo d’uomo, il suo migliore amico. Era il suo primo quando a 16 anni l’aveva deflorata per gioco, voleva sapere, capire. La vita, le circostanze e i genitori li avevano separati, ma non perdevano mai l’occasione di ritrovarsi. Finiva sempre così, si addormentava in lei, la possedeva totalmente.
Pierre Dupuis aprì la porta con difficoltà, la chiave sembrava non voler entrare nella serratura. Pioveva quella notte e il ritorno era stato faticoso. I fari che lo accecavano, le nuvole d’acqua che sbattevano l’auto come un mare agitato, i tergicristalli che non seguivano, una tortura, più volte si era fermato, In una zona di sosta. Voleva essere in grado di pensare.
Cosa avrebbe detto? Carmen era stata intransigente, doveva dichiararsi oggi, altrimenti era finita. Era così felice con lei, la sua vita sessuale era piena, Carmen sapeva come portarlo al di là di se stesso, non aveva limiti la sua immaginazione superava tutto quello che lui avesse mai sognato. Con Maria sua moglie c’era sempre qualcosa, la luce, i vicini che potevano vederli, lei aveva le sue regole, i bambini si sarebbero svegliati…
George era sotto la doccia, questa era caldissima e questo ha ravvivato il suo desiderio. Madeleine era una donna eccezionale, lei era la sua migliore amica, lo capiva, sapeva anticipare quello che avrebbe voluto ma soprattutto con lei andava bene, Poteva parlare per ore insieme. Si conosceva come fratello e sorella. Con Carmen non si incontravano mai. Il loro matrimonio era stato una cerimonia brillante, sotto il fuoco dei media ovviamente. Era il loro interesse, la loro fama fu riportata in auge, per pochi anni. Girarono un solo film insieme.
Non dubitava e si diresse di nuovo verso letto.
Pierre, completamente inzuppato, si tolse l’impermeabile e la giacca. Portava la fondina alla spalla, esitava a tenerla o no. Il suo lavoro era di non lasciarlo mai, poi c’era la scena che sarebbe seguita. Non si vedeva che dichiarasse a Maria di avere un’amante e che la volesse lasciare in tenuta da lavoro.
Cosa avrebbe detto?
Non era un’amante eccezionale, ma era una madre ammirevole. Avevano avuto due gemelli. Ne era così orgoglioso. Era lei che aveva saputo allevarli, sapeva essere dura e severa, ma anche dolce e carezzevole e lui che per mestiere era così spesso assente. Quando Carmen girava in Europa, poteva durare mesi. È salita al piano dove si trovavano le camere. Passò davanti alla camera dei gemelli che era socchiusa. Guardò la porta silenziosa della moglie e si ricordò della nascita dolorosa di John e Jonathan. Maria aveva sofferto mille morti. Non poteva lasciarla così.
Quella Carmen che lo dominava, lo imprigionava con il sesso, non poteva togliergli questo, questa famiglia piena d’amore e di tenerezza. Guardò di nuovo i gemelli nella loro stanza decorata come un campo indiano. Tirò fuori la pistola e si ricordò degli infiniti giochi che il suo arrivo in macchina scatenava. Gli attacchi alla diligenza, «paf, paf», i colpi che simulava per difendersi dai suoi piccoli indiani tutti dipinti e coperti di piume.
Improvvisamente un lungo e spaventoso grido uscì dalla camera di Maria.
Madeleine aprì le gambe molto forte, poi le strinse sul dorso del suo amante affinché penetrasse nel profondo di sé. Il suo grido era infinito come l’orgasmo che la scuoteva così terribilmente. La porta volò in frantumi, Pierre che urlava anche lui scaricò i sei colpi della sua pistola nella schiena sanguinante, squarciata di Georges Cloen. Il braccio di Marie Madeleine Dupuis cadde inerte sul letto, sul fianco del suo corpo senza vita.